Catalogue > Faire une recherche
Résultats pour : Tout le catalogue


Dara Birnbaum
Technology/Transformation: Wonder Woman
Vidéo | 0 | couleur | 5:50 | USA | 1979
Explosive bursts of fire open Technology/Transformation, an incendiary deconstruction of the ideology embedded in television form and pop cultural iconography. Appropriating imagery from the 1970s TV series Wonder Woman, Birnbaum isolates and repeats the moment of the "real" woman's symbolic transformation into super-hero. Entrapped in her magical metamorphosis by Birnbaum's stuttering edits, Wonder Woman spins dizzily like a music-box doll. Through radical manipulation of this female Pop icon, she subverts its meaning within the television text. Arresting the flow of images through fragmentation and repetition, Birnbaum condenses the comic-book narrative — Wonder Woman deflects bullets off her bracelets, "cuts" her throat in a hall of mirrors — distilling its essence to allow the subtext to emerge. In a further textual deconstruction, she spells out the words to the song Wonder Woman in Discoland on the screen. The lyrics' double entendres ("Get us out from under... Wonder Woman") reveal the sexual source of the superwoman's supposed empowerment: "Shake thy Wonder Maker." Writing about the "stutter-step progression of 'extended moments' of transformation from Wonder Woman," Birnbaum states, "The abbreviated narrative — running, spinning, saving a man — allows the underlying theme to surface: psychological transformation versus television product. Real becomes Wonder in order to "do good" (be moral) in an (a) or (im)moral society."
For four decades, Dara Birnbaum's pioneering works in video, media and installation have questioned the ideological and aesthetic character of mass media imagery, and are considered fundamental to our understanding of the history of media practices and contemporary art. Dara Birnbaum was born in New York City in 1946 where she continues to live and work. Dara Birnbaum received a B.A. in architecture from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, a B.F.A. in painting from the San Francisco Art Institute, and a certificate in video and electronic editing from the Video Study Center at the New School for Social Research in New York. Dara Birnbaum was one of the first artists to develop complex and innovative installations that juxtapose images from multiple sources while incorporating three-dimensional elements - large-scale photographs, sculptural or architectural elements - into the work. She is known for her innovative strategies and use of manipulated television footage. Birnbaum's work has been exhibited widely at MoMA PS1, New York (2019); National Portrait Gallery, London (2018); Cleveland Museum of Art, Ohio (2018); South London Gallery, UK (2011); major retrospectives at Serralves Foundation, Porto, Portugal (2010) and S. M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, Belgium (2009); Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu (2009); Museum of Modern Art, New York (2008); Kunsthalle Wien, Vienna, Austria (2006); and The Jewish Museum, New York (2003). His work has been exhibited at Documenta 7, 8 and 9. Birnbaum has won several prestigious awards including: John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2021); The Rockefeller Foundation Bellagio Center Arts Residency (2011); the Pollock-Krasner Foundation Grant (2011); and the prestigious United States Artists Fellowship (2010). In 2016, she was recognized and honored for her work by The Kitchen, New York, at their annual gala. She was the first woman in video to receive the prestigious Maya Deren Award from the American Film Institute in 1987. In February 2017, Carnegie Mellon University's School of Art established the Birnbaum Award in her honour.
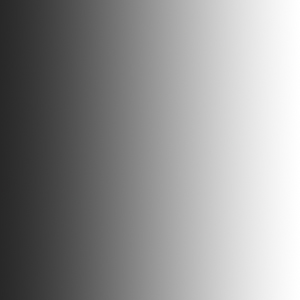
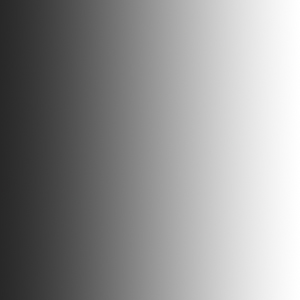
Dara Birnbaum
Kiss the Girls: Make Them Cry
Vidéo | 0 | couleur | 6:26 | USA | 1979
Birnbaum manipulates off-air imagery from the TV game show Hollywood Squares in Kiss The Girls: Make Them Cry, a bold deconstruction of the gestures of sexual representation in pop cultural imagery and music. Minor celebrities (who Birnbaum terms "iconic women and receding men") confined in a flashing tic-tac-toe board greet millions of TV viewers, animating themselves as they say "hello." Birnbaum isolates and repeats these banal and at times bizarre gestures of male and female presentation — "repetitive baroque neck-snapping triple takes, guffaws, and paranoid eye darts" — wrenching them from their television context to expose stereotyped gestures of power and submission. Linking TV and Top 40, Birnbaum spells out the lyrics to disco songs ("Georgie Porgie puddin' and pie/kissed the girls and made them cry") with on-screen text, as the sound provides originally scored jazz interpolation and a harsh new wave coda. The result is a powerful, layered analysis of the meaning of the gestures of mass cultural idioms.
For four decades, Dara Birnbaum's pioneering works in video, media and installation have questioned the ideological and aesthetic character of mass media imagery, and are considered fundamental to our understanding of the history of media practices and contemporary art. Dara Birnbaum was born in New York City in 1946 where she continues to live and work. Dara Birnbaum received a B.A. in architecture from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, a B.F.A. in painting from the San Francisco Art Institute, and a certificate in video and electronic editing from the Video Study Center at the New School for Social Research in New York. Dara Birnbaum was one of the first artists to develop complex and innovative installations that juxtapose images from multiple sources while incorporating three-dimensional elements - large-scale photographs, sculptural or architectural elements - into the work. She is known for her innovative strategies and use of manipulated television footage. Birnbaum's work has been exhibited widely at MoMA PS1, New York (2019); National Portrait Gallery, London (2018); Cleveland Museum of Art, Ohio (2018); South London Gallery, UK (2011); major retrospectives at Serralves Foundation, Porto, Portugal (2010) and S. M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, Belgium (2009); Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu (2009); Museum of Modern Art, New York (2008); Kunsthalle Wien, Vienna, Austria (2006); and The Jewish Museum, New York (2003). His work has been exhibited at Documenta 7, 8 and 9. Birnbaum has won several prestigious awards including: John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2021); The Rockefeller Foundation Bellagio Center Arts Residency (2011); the Pollock-Krasner Foundation Grant (2011); and the prestigious United States Artists Fellowship (2010). In 2016, she was recognized and honored for her work by The Kitchen, New York, at their annual gala. She was the first woman in video to receive the prestigious Maya Deren Award from the American Film Institute in 1987. In February 2017, Carnegie Mellon University's School of Art established the Birnbaum Award in her honour.
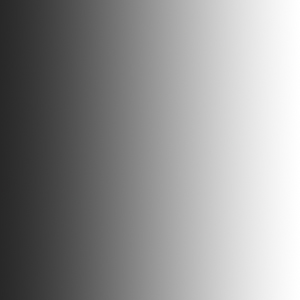
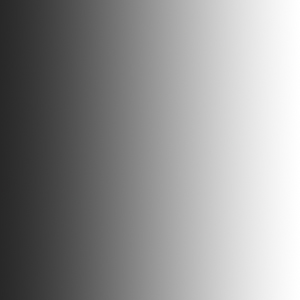
Dara Birnbaum
Fire!/Hendrix
Vidéo | 0 | couleur | 3:13 | USA | 1982
Commissioned by VideoGram International, Ltd., for a videodisc of music by Jimi Hendrix, Fire! uses the stylized visuals and pacing of a music video to critique the representational economies of sexuality and consumerism. Translating the psychedelic fervor of the Hendrix song into a contemporary visual vernacular, Birnbaum similarly recasts the lyrics' meaning. A young woman is the "protagonist" of a fragmented narrative in which Birnbaum re-frames images of American consumerism and commodities — fast food, cars, the exchange of money. Birnbaum calls attention to the woman's relation to the advertising image: she is consumed as she is consuming.
For four decades, Dara Birnbaum's pioneering works in video, media and installation have questioned the ideological and aesthetic character of mass media imagery, and are considered fundamental to our understanding of the history of media practices and contemporary art. Dara Birnbaum was born in New York City in 1946 where she continues to live and work. Dara Birnbaum received a B.A. in architecture from Carnegie Mellon University in Pittsburgh, a B.F.A. in painting from the San Francisco Art Institute, and a certificate in video and electronic editing from the Video Study Center at the New School for Social Research in New York. Dara Birnbaum was one of the first artists to develop complex and innovative installations that juxtapose images from multiple sources while incorporating three-dimensional elements - large-scale photographs, sculptural or architectural elements - into the work. She is known for her innovative strategies and use of manipulated television footage. Birnbaum's work has been exhibited widely at MoMA PS1, New York (2019); National Portrait Gallery, London (2018); Cleveland Museum of Art, Ohio (2018); South London Gallery, UK (2011); major retrospectives at Serralves Foundation, Porto, Portugal (2010) and S. M.A.K. Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Ghent, Belgium (2009); Center for Contemporary Art, CCA Kitakyushu (2009); Museum of Modern Art, New York (2008); Kunsthalle Wien, Vienna, Austria (2006); and The Jewish Museum, New York (2003). His work has been exhibited at Documenta 7, 8 and 9. Birnbaum has won several prestigious awards including: John Simon Guggenheim Memorial Foundation Fellowship (2021); The Rockefeller Foundation Bellagio Center Arts Residency (2011); the Pollock-Krasner Foundation Grant (2011); and the prestigious United States Artists Fellowship (2010). In 2016, she was recognized and honored for her work by The Kitchen, New York, at their annual gala. She was the first woman in video to receive the prestigious Maya Deren Award from the American Film Institute in 1987. In February 2017, Carnegie Mellon University's School of Art established the Birnbaum Award in her honour.
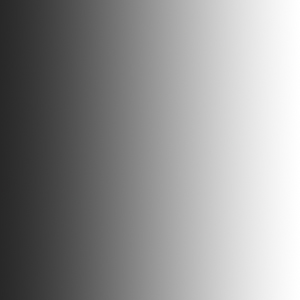
José Miguel Biscaya
Neuland
Vidéo | dv | couleur | 7:22 | Portugal, Pays-Bas | 2009
Neuland - 7min 22sec - 4:3 - dv_pal - 2009 A dutch landscape. The video-work `Neuland` (Virgin Soil, Unknown Territory) belongs to a series of landscape studies. The definition of the `Argument` and the `By-work` is questioned. It remains unclear if the `Argument` refers to the subject aimed by the camera or the one passing by. The attention is turned to an artificial landscape which stands for modernity and progress. Routine reveals itself as mechanical ritual. Seen from this perspective there is no place for the individual.
Biography José Miguel Biscaya, born in Lisbon in 1973, is a Mixed-Media Artist and Curator living and working in Amsterdam. He graduated at the Sandberg Institute where he received his Master-degree in Fine Arts (MFA). His work has been shown in numerous international festivals and group-exhibitions. He co-curated and produced several shows, including Volume and Hiscox Art Award. In 2007, he created in association with Jonathan Sullam and Tom Hillewaere the Mobile Institute in Brussels. As a jury member of the Media Art Friesland commission in 2009, José co-curated and lined up the Friesland International Media Art Competition program. Currently he is working on a new series of video-works.


Rossella Biscotti, Kevin VAN BRAAK
New Crossroads
Doc. expérimental | dv | couleur | 21:11 | Italie, Pays-Bas | 2006
Quelques habitants de New Crossroads (Cape Town), tentent de transformer un lieu par une intervention non fonctionnelle. Dans un espace public, ils construisent une tour de cinq mètres en empilant des poutres en bois peintes en vert vif. Quand la structure atteint son sommet, d'autres résidents sont invités à venir la démanteler et à prendre les matériaux pour leur usage personnel. La tour prend ainsi tout son sens une fois détruite et fragmentée. L'image de la tour comme symbole unique et point de référence de la ville disparaît dans l'horizontalité du quartier.
La collaboration entre les deux artistes Rossella Biscotti (Molfetta, Italie, 1978) et Kevin van Braak (Warnsveld, Pays-Bas, 1975) a commencé avec le projet de New Crossroads à Cape Town (Afrique du Sud). L'oeuvre est basée sur leur intérêt commun pour la relation entre l'environnement réel, pur ou idéaliste et le contexte fictionnel, créé par l'homme dans la société contemporaine. Les deux artistes ont également collaboré à différents projets impliquant la photographie, les installations et la sculpture. En 2006, ils ont réalisé un deuxième film, "The renovation of the empty bath", sur la rénovation d'une piscine à Rome, construite pendant la période fasciste. Ensemble, ils ont exposé au Fonds BKVB à Amsterdam, à l'American Academy de Rome et à la Fondazione Adriano Olivetti à Rome. Séparément, ils ont aussi exposé dans différents galleries et musées.


Rossella Biscotti
The Undercover Man
Film expérimental | 16mm | noir et blanc | 30:0 | Italie, USA | 2008
L?agent du FBI Joseph D. Pistone, alias Donnie Brasco, est interrogé par l'artiste sur ses six années d?opération au sein de la mafia américaine (1976-1982). Pistone a été le premier agent du FBI à avoir réussi à infiltrer la mafia new-yorkaise, et à livrer au FBI des informations internes sans jamais être découvert. Il a réussi à la fois à impliquer certains membres de la mafia dans des activités criminelles entièrement mises en place par le FBI et à introduire d'autres agents du FBI en tant qu?« associés criminels ». Le film est tourné dans un décor, spécialement dessiné et construit à l?occasion, qui revisite l'esthétique du film noir des années 1940. Le mythe de la pègre, la double face de la réalité (la tombée de la nuit et la lumière, l'enquêteur et le suspect), relie l'histoire de Joseph D. Pistone à celle des gangsters ainsi qu?à la connaissance que nous en avons à travers le cinéma américain.
Rossella Biscotti est née à Molfetta (Italie) en 1978. Elle vit et travaille actuellement à Rotterdam (Pays-Bas). Elle est devenue célèbre grâce à ses vidéos sur les traces de la vie des autres, généralement des anonymes de l'histoire. Ils constituent des sources stimulantes pour mener une réflexion sur la situation (collective et personnelle) de l'identité et de la mémoire aujourd?hui. En 2007, sa vidéo « The Sun Shines in Kiev » a remporté le Grand Prix de la Ville de Genève lors de la 12e Biennale de l'Image en Mouvement du Centre pour l'Image Contemporaine de Genève, et la Vache d'Or du Gstaadfilm de Gstaad (Suisse).


Jules Bishop
Pay & display
Fiction | 35mm | couleur | 12:0 | Royaume-Uni | 2004
Interweaving stories inside a multi-storey car park.
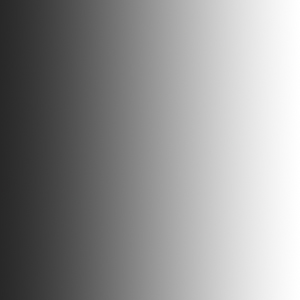
Hisham Bizri
A Film
Film expérimental | 16mm | noir et blanc | 8:32 | Liban, USA | 2010
This is a film poem about love. A Lebanese-American filmmaker photographs a woman in Paris: as a trapeze artist, a model, a lover, and a child. The film attempts to capture that moment between wakefulness and dream. It carries within it melancholy and loneliness, sadness and joy, adulthood and childhood. It evolves out of the metaphor that life is a circular journey whose end is "to arrive where we started / And know that place for the first time" (T.S. Eliot, Little Gidding).
Hisham Bizri is a Lebanese-American filmmaker born in Beirut. He has made several short films and has had retrospectives and screenings at Anthology Film Archives and MOMA in NYC, Centre Georges Pompidou and the Cinémathèque Française (Paris), Cairo Opera House (Egypt), among others. He has worked with Raùl Ruiz and Miklós Jancsó and was a jury member at several international film festivals, including the Chicago International Film Festival. Hisham has won several awards such as the Guggenheim and the American Academy Rome Prize. He is currently working on his feature "Until Morning" with producer Andrew Fierberg.


Hisham Bizri
Asmahan
Film expérimental | 35mm | noir et blanc | 21:20 | Liban | 2005
Asmahan est une méditation visuelle et filmique au motif avant-gardiste. Le film est fondé sur Gharam Wa Intiqam (Passion et vengeance, 1944) le dernier film d?Asmahan, une chanteuse Egypto-syrienne née en 1912 et morte en 1944. Sa forme filmique mélange les chansons d?Asmahan avec une intrigue et de l?action pour montrer un aperçu de la relation entre la vie tragique de la star dans l?Egypte coloniale et la nature du cinéma.
Hisham est un réalisateur libanais. Il a étudié aux Etats Unis avec les réalisateurs Raoul Ruiz et Miklós Jancsó et a donné des cours sur la réalisation aux Etats-Unis, au Liban, en Irlande, en Corée, en France et au Japon. La plupart de son travail peut être vu comme des méditations sur les thèmes de l?exile et de la mélancolie. Ces méditations visuelles sont forgées sur le mélange qu?il a lui-même expérimenté entre le Moyen Orient et son éducation arabo-musulmane et l?art et la culture anglo-européenne. Son travail, qui prend son inspiration de ce contexte personnel, est le reflet de préoccupations politiques et sociales vis-à-vis de la politique arabe contemporaine et de la culture ainsi que de préoccupations esthétiques vis-à-vis des valeurs picturales et de la poétique de la vie moderne. Son travail a été montré dans le monde arabe ainsi qu?à l?échelle internationale, comme par exemple au Louvre, au Cairo Opera House en Egypte, à la Biennale Des Cinéma Arabes à Paris, au Milan Film Festival en Italie, au Walker Art Center à Minneapolis, à l?Institut du Monde Arabe à Paris, aux Harvard Film Archives à Cambridge, et au Museum of Modern Art à New York.


Hisham Bizri
Asmahan
Film expérimental | 35mm | noir et blanc | 20:0 | Liban | 2005
Asmahan est l`histoire d`une femme qui prend la vengeance sur l`homme qu`elle pense a tué son mari, mais tombe amoureuse de lui pendant l'opération. Pendant le pelliculage, l`actrice dans le film qui chante les deux belles chansons sur la bande sonore, meurt dans un accident de voiture et la fin a dû être changée de sorte que son personnage meure également. Asmahan est une vraie personne qui était la figure quintessencielle du péché et de la liberté aux femmes dans le monde arabe. Elle a laissé sa maison et mari en Syrie dans les années 30 pour poursuivre la renommée en Egypte. Elle a été assassinée en 1944 et son meurtre demeure un mystère, on dit qu'elle était un agent double, travaillant pour les gouvernements britanniques et égyptiens. La vie d`Asmahan a été enveloppée dans le mythe, l`intrigue et plusieurs histoires au sujet de son attitude moderne dans la vie. Elle fumait et buvait, et ses liaisons romantiques continuent à produire une aura autour d`elle-même après sa mort. Mon film montre son aura par un langage cinématographique inspiré de sa chanson, de sa vie.
Hisham est un réalisateur libanais. Il a étudié aux USA avec des réalisateurs Raoul Ruiz et Miklós Jancsó et a enseigné réalisation aux Etats-Unis, au Liban, en Irlande, en Corée, en France, et au Japon. Beaucoup de son travail peut être vu comme des méditations sur les thèmes de l`exil et de la mélancolie. Ces méditations visuelles sont formées par son expérience personnelle à l`intersection entre le Moyen-Orient de son éducation d`Arabo-Musulmane et son art et culture Anglon-Européenne. Émergeant de ce contexte personnel, son travail reflète des soucis politiques et sociaux envers la politique et culture arabe contemporaine et une inquiétude esthétique envers le mantra des valeurs et de la poésie de la vie moderne. Son travail a été montré dans le monde arabe et internationalement, y compris et entre autres au musée du Louvre (France), la Biennale Des Cinéma Arabes (Paris, France), au festival du film de Milan (Italie), au Walker Art Museum (Minneapolis), à l'Institut du Monde Arabe (Paris), au Museum of Modern Art (New York).


Hisham Bizri
Song for the Deaf Ear
Film expérimental | 16mm | couleur et n&b | 17:0 | Liban | 2008
« Song for the Deaf Ear » est une méditation cinématographique sur la folie de la guerre et la violence au Liban, le pays de l?auteur.
Hisham est un cinéaste libanais. Il a étudié aux Etats-Unis avec les réalisateurs Raoul Ruiz et Miklos Jancso et donné des conférences sur le cinéma aux Etats-Unis, au Liban, en Irlande, en Corée, en France et au Japon. Une grande partie de son ?uvre peut être considérée comme une méditation sur les thèmes de l'exil et de la mélancolie. Son ?uvre a été montrée dans le monde arabe ainsi qu?à l?échelle internationale, notamment au Musée du Louvre de Paris (France), à la Biennale du Cinéma Arabe de Paris, au Festival du Film de Milan (Italie), au Walker Art Center de Minneapolis (USA), à l'Institut du Monde Arabe de Paris, aux Harvard Film Archives de Cambridge (USA), au Reina Sofia de Madrid (Espagne), au Museum of Modern Art de New York (USA), à la Cinémathèque Française de Paris, au Centre Pompidou de Paris, à l?Opéra du Caire (Égypte), entre autres.

Ingrid Bjørnaali, Maria Simmons, Fabian Lanzmaier
Land Bodies, Decomposing Mass
Installation vidéo | hdv | couleur | 22:16 | Norvège | 2023
Land Bodies, Decomposing Mass is an audiovisual collaboration between Ingrid Bjørnaali, Maria Simmons and Fabian Lanzmaier, focusing on preserved peatlands and their interpretation through various recording and 3D computing technologies. Through the use of photogrammetry, a technology that relates to satellite mapping and archiving of anthropocentric spaces and monuments, the biotope is interpreted bit by bit in an intimate, close-up interaction. The work explores specific peatlands in Finland, Norway and Canada from various perspectives, focusing on the idea of natural landscapes as sources as opposed to resources, and their capability or not to be translated to binary code.
Ingrid Bjørnaali is a multidisciplinary artist based in Oslo who records specific biotopes in various states of their ongoing world-building processes. Her works explore the omnipresence of the digital in our experience of the world as well as the inability of technology to articulate matter’s complexity. Recent exhibitions include Screen City Biennial, Berlin, Fabbrica Del Vapore, Milan, Charles Street Video, Toronto and Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM). Fabian Lanzmaier is a musician and sound artist living in Vienna. In his practice he explores perception and ideas of natural / artificial sounds, fluid and ambiguous environments. He works with real-time audio synthesis utilizing digital/analog physical modeling techniques and feedback networks to explore aspects of texture and structure of sound as well as its presence within space. Recent projects include: Artist in Residency at Wave Farm – NY, composition commission through INA - grm - Paris, AV - Performance at Fridman Gallery - NYC and Artist in Residency at EMS – Stockholm. Maria Simmons is a Canadian symbiontic artist who investigates potentialized environments through the creation of hybrid sculptures and installations. Her work embraces contamination as an act of collaboration. She collects garbage, grows yeast, ferments plants, and nurtures fruit flies. She makes art that eats itself. Recent solo exhibitions include the Visual Art Centre of Clarington, Trinity Square Video, and Centre3.

Piotr Blajerski
UNCERTAINTY
Fiction expérimentale | hdv | noir et blanc | 8:0 | Pologne | 2014
The short film UNCERTAINTY is like Ouroboros, has no beginning and no end. The important aspect of the plot is constant change of the perspective between the observer and the observed person. This endless inversion and slow close-ups create the atmosphere of uncanny epidemic. Uncertainty is the effect of being infected by a microbe which forced a victim to intense observation of the surrounding world. The final aim is to not get concentrated on any specific element or quality but to exceed the cognitive habits. The suspended certainty of the existence forces all observers to look through the images of so-called reality. Their behavior may look absurdly, although it’s based on the promise given by our culture: there must be something beyond the visible world.
Born in 1980 in Wroclaw, Poland where he lives and works. Since 2004 studied at The Academy of Fine Arts and Design in Wroclaw. Received MA Degree in Media Arts in 2011. Founder and director at EMDES gallery which existed between 2009 and 2011.


Philippe Blanchard
Taco Monde
Animation | dv | couleur | 2:30 | Canada | 2005
Une exploration animée de la culture populaire et du fast-food nord-américains, mêlant l`absurde à l`obsessionnel et abordant entre autres les thèmes de la surcharge sensorielle et l`omniprésence de l`intéractivité dans les médias.
Formé en cinéma et beaux-arts à l`Université Concordia (Montréal, Canada), Philippe Blanchard a ensuite travaillé quelques années en Amérique Latine et au Moyen-Orient pour finalement suivre une formation en effets spéciaux numériques au College Seneca (Toronto). Il travaille présentement pour le studio d`animation Head Gear Animation à Toronto.


Vicente Blanco
The Proll Thing
Animation | dv | couleur | 3:27 | Espagne | 2006
Le projet « The Proll Thing » comprend une vidéo d?animation sur deux écrans ainsi qu?une vidéo réalisée avec un téléphone portable. L?idée est de distribuer la narration entre différents médias, et de voir comment cette information s?articule en différents niveaux dans l?espace de projection. Le point de départ de l?auteur est le restaurant Kino International de Berlin-Est. L?actuelle « police de l?image » de ce bâtiment interdit qu?on prenne des photos à l?intérieur (même si le lieu est ouvert au public pendant la projection des films). L?auteur a pensé à l?animation comme moyen de représenter l?intérieur du bâtiment, car il lui semblait possible de recréer cet intérieur en mélangeant la réalité et la fiction. Pour réaliser ce montage, il a intégré différents éléments, réels ou imaginaires, qui créent des situations nouvelles. Les dessins pour les décors de la vidéo sont basés sur une série de cartes postales vendues comme souvenir à l?entrée du cinéma.
Vicente Blanco est né à Cee (Espagne) et est diplômé de l?Académie des Beaux-Art de la Faculté de Potevedra (Université de Vigo, Espagne). Il a bénéficié, entre autres, d?une bourse de perfectionnement à la Claremont Graduate University de Los Angeles (USA), de la subvention « Generation 2000 » de la part de Caja Madrid, ainsi que de la bourse de l?Unión Fenosa et Beca Endesa, qui lui a permis de vivre à Madrid. Il a participé à de nombreuses expositions collectives, notamment « Urbanitas » à MARCO (Vigo, Espagne), « ¿Viva pintura! » à Salzburg (Autriche) et « 16 x 16, 16 proyectos de arte español » pour ARCO?06. Ses expositions individuelles ont eu lieu au CGAC en 2003 (« Lo que se espera de nosotros »), à l?Espacio Uno du Musée Reina Sofía en 2004 (« Alguna vez pasa cuando estáis dormidos ») et à la galerie Elba Benitez Gallery en 2006 (« Otra vez algo nuevo »).


Viktor Blanke
End of Level
Animation | dv | couleur | 7:15 | Suède, Royaume-Uni | 2005
"End of Level" est une oeuvre courte animée, fusionnant des pixels 2D avec l'animation 3D. La grande bataille entre un artiste de rue et un directeur artistique s'amplifie au son des beats obtenus avec une Gameboy Nintendo. Les hommes pixélisés se battent pour la suprématie, à travers la reproduction, la subversion, un convertisseur analogique-numérique et la réparation. Reconfigurer le système de signes de la ville est une bataille épique sans fin.
Victor Blanke est né à Stockholm, Suède, en 1980. Diplômé du Central Saint Martins College of Art and Design et de la Stockholm Filmschool, son travail a été présenté au Festival du Film de Stockholm, au Subörb Festival, et dans des publications telles que The Face et Adbusters Magazine. Parmi ses oeuvres publicitaires on trouve de nombreuses vidéos et publicités musicales pour des artistes tels que Paul McCartney, Shelly Poole, Håkan Lidbo et mutagene.


Ansuya Blom
Hither come down on me
Film expérimental | 16mm | noir et blanc | 11:15 | Pays-Bas | 2007
"Hither come down on me?" est le troisième et dernier volet de la série "Cowboys et Indiens". Comme dans les deux parties précédentes, "Chapter Three" et "Nervous", l?anxiété domine. C?est ici le langage qui émeut, et produit une expérience auditive. Dans ce troisième chapitre, la perception de la première personne du singulier est déformée par l?expérience de l?espace, tandis que dans "Nervous", la nature transformée en environnement de tournage peut être perçue comme doublement négative, car elle est à la fois familière et étrangère. Dans "Hither come down on me", l?anxiété est évoquée par le biais d?une confrontation avec la ville, cet environnement externe qui est littéralement opposé à la sphère domestique. Le protagoniste expérimente ce qu?il voit et entend comme une forme directe de communication, une voix s?adressant directement à lui et lui donnant des ordres.
Ansuya Blom travaille comme artiste depuis 1977. Elle est peintre et réalisatrice. Son travail traite de l?individu et de sa relation avec le monde interne et externe. La première personne du singulier est le moyen employé pour réfléchir à cette relation de l?individu au monde et aux stratégies qu?il emploie pour gérer l?anxiété. Dans les films d? Ansuya Blom, le monde est perçu au-travers des yeux et oreilles du protagoniste. Son travail a été exposé dans de nombreux musées et galeries aux Pays-Bas et ailleurs. Une exposition individuelle de ses peintures et films a été organisée au centre d?art de Camden, à Londres, ainsi qu?à la galerie Douglas Hyde de Dublin et au Stedelijk Museum d?Amsterdam. Ses films ont notamment été diffusés au Musée d?Art Moderne de New York.
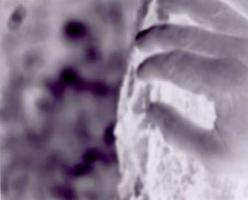
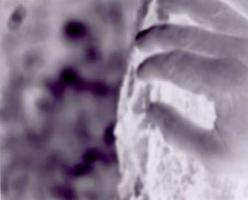
Ansuya Blom
Nervous
Vidéo expérimentale | dv | noir et blanc | 9:21 | Pays-bas | 2004
Court-métrage basé sur une histoire écrite par Robert Walser. Il y décrit son état d'esprit, lequel oscille quelque part entre l'optimisme et le désespoir. Ses pensées sont lues à haute voix lors d'une promenade à la campagne. Doucement on passe de la nature extérieure à la nature intérieure.
Ansuya BLOM (Groningen 1956) a etudié de 1973 à 1974 à la Royal Academy de La Hague et de 1974 à 1976 aux Ateliers '63 à Haarlem. Ses peintures ont été notamment exposées au Stedelijk Museum à Amsterdam. Elle a également participé à de nombreuses expositions collectives à travers le monde.

Ansuya Blom
SPELL
Vidéo | hdv | noir et blanc | 6:31 | Pays-Bas | 2012
SPELL is a short video documenting the thoughts of a man who seems to be in a state between sleep and wakefulness. The sounds he hears within the space where he lives seem to invade his thoughts and get amplified. They mix with associative sounds from his past. Meanwhile the reality around him appears to deform at times. In this in-between world he tries to het a grip on his state, contemplating early beginnings but at the same time mocking his own state, the futility of actions and the daily rituals of existence. The images for this film were shot in the Doesburg Foundation in Meudon, during a residency in 2010 - 2011. The house, with it`s historic past bore many traces from history and the people that had stayed there. This absent presence was a motivating factor in making this film. The words of Franz Kafka speak for themselves and it was the strange mix of humour and despair that attracted me.
Biography Ansuya Blom Ansuya Blom works as an artist using the media of drawing and film. Her work focuses on the individual and the relation to the internal as well as the external world. ?The first person singular? is used by way of thinking about the position of the individual. Ansuya Blom is interested in the strategies this individual adopts in dealing with anxieties that are induced by alienation. In her films the world is seen through the protagonists` eyes and heard through their voices. Ansuya Blom`s work has been exhibited extensively in both galleries and museums in the Netherlands as well as abroad. Solo-exhibitions of her work have been held at Camden Art centre, London, Douglas Hyde Gallery in Dublin, and the Stedelijk Museum in Amsterdam. The Museum of Modern Art in New York has been among the venues where her films have been screened. She is an advisor at the Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.
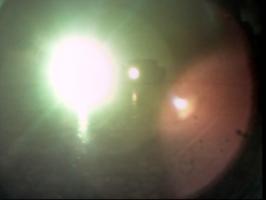
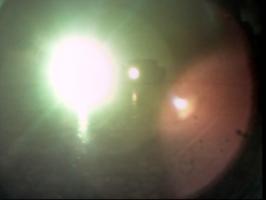
Maria Blondeel, Michael VORFELD
Wireless, Even Through Walls
Vidéo expérimentale | dv | couleur | 9:0 | Belgique, USA | 2005
Une improvisation vidéo avec deux Kodak Ektagrahic III E Plus Slide Projector avec pax et transpax ; connexion pour contrôle externe, oscillateur FM avec senseur de lumière, enregistreur numérique et lentilles vidéos dirigés par Maria Blondeel : lampe incandescente verte, différentes ampoules, tube fluorescent, microphones, repiquages et appareillages électriques divers manoeuvrés par Michæl Vorfeld. Enregistré à Hyde Park Art Center, Outer Ear Festival of Sound ESS, Chicago, Illinois, États-Unis, 2002. Produit par Blondeel/Vorfeld 2005.
En tant que duo réalisant des spectacles, BlondeelVorfeld ont été actifs depuis 1996 ; L'un est artiste en sons éléctroniques et l?autre est percussionniste, l'un projetant la lumière, l?autre utilisant les sources de lumières presque comme des objets. Ce que l?on entend et voit est un dialogue en contrepoint entre des ondes carrées de lumière contrôlée et analogues et des sons électriques accompagnant ou accompagnés par des évènements de lumières projetée sur et dans des lumières, blanc éclatant et des couleurs jaunes, bleues ou rouges incandescentes. Maria Blondeel est une artiste intermédia basée à Ghent, en Belgique. Elle a fait des installations de lumière sonique ainsi que des ?uvres spécifiques à certains lieux pour des véhicules, des téléphones et de la radio. Elle a aussi participé à des concerts et des performances en collaboration avec des musiciens et produit des travaux pour des CD et des vidéos. Son travail a été exposé dans des galeries, des musées et des festivals en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Micheal Vorfeld est basé à Berlin. C?est un musicien et un artiste visuel. Il joue des percussions et des instruments à cordes qu´il créé lui-même, et réalise des ?uvres dans le domaine de la musique expérimentale, la musique improvisée et l?art sonore. Il réalise aussi des morceaux sonores électro-acoustiques. Son travail visuel se concentre sur l?utilisation de la lumière. Il crée des installations et des spectacles avec de la lumière, souvent spécifique aux lieux et en combinaison avec dès sons électriques ou instrumentaux. Sa liste d?activités comprend de nombreux concerts, spectacles et performances en Europe, aux États-Unis, en Asie et en Australie.
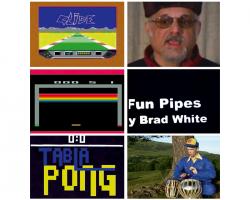
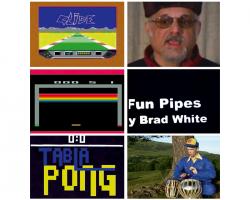
Jaygo Bloom
Continue play?
performance | dv | couleur | 5:46 | Royaume-Uni | 2005
`CONTINUE PLAY?` est l?un d?une série de projets inspirés par des jeux et qui vous présente des classiques des jeux d?arcade des années 70 : `BREAK-OUT` `ELEKTRAGLIDE` et `PONG` avec une amélioration de l?accompagnement audiovisuel. Les techniques de ?jeux? particulières de JAYGO BLOOM?S apportent la structure et la tempe pour une réponse Audio Visuelle alternative, on répond construite à partir ?tutoriaux personnels musicaux? mal expliqués tout autant que télécharger au hasard.